La Renaissance du Farsi : de Rudaki à Ferdowsi, la voix retrouvée du Khorasan
À l’aube du IXe siècle, dans une région encore marquée par l’héritage arabo-musulman, une voix nouvelle s’élève dans les plaines du Khorasan. Cette voix, douce mais ferme, chante dans une langue qu’on croyait effacée : le farsi. À sa tête, un homme : Rudaki, souvent considéré comme le père de la poésie persane classique. Il sera bientôt suivi par Ferdowsi, le monument de l’épopée, qui scellera à jamais le destin de cette langue.
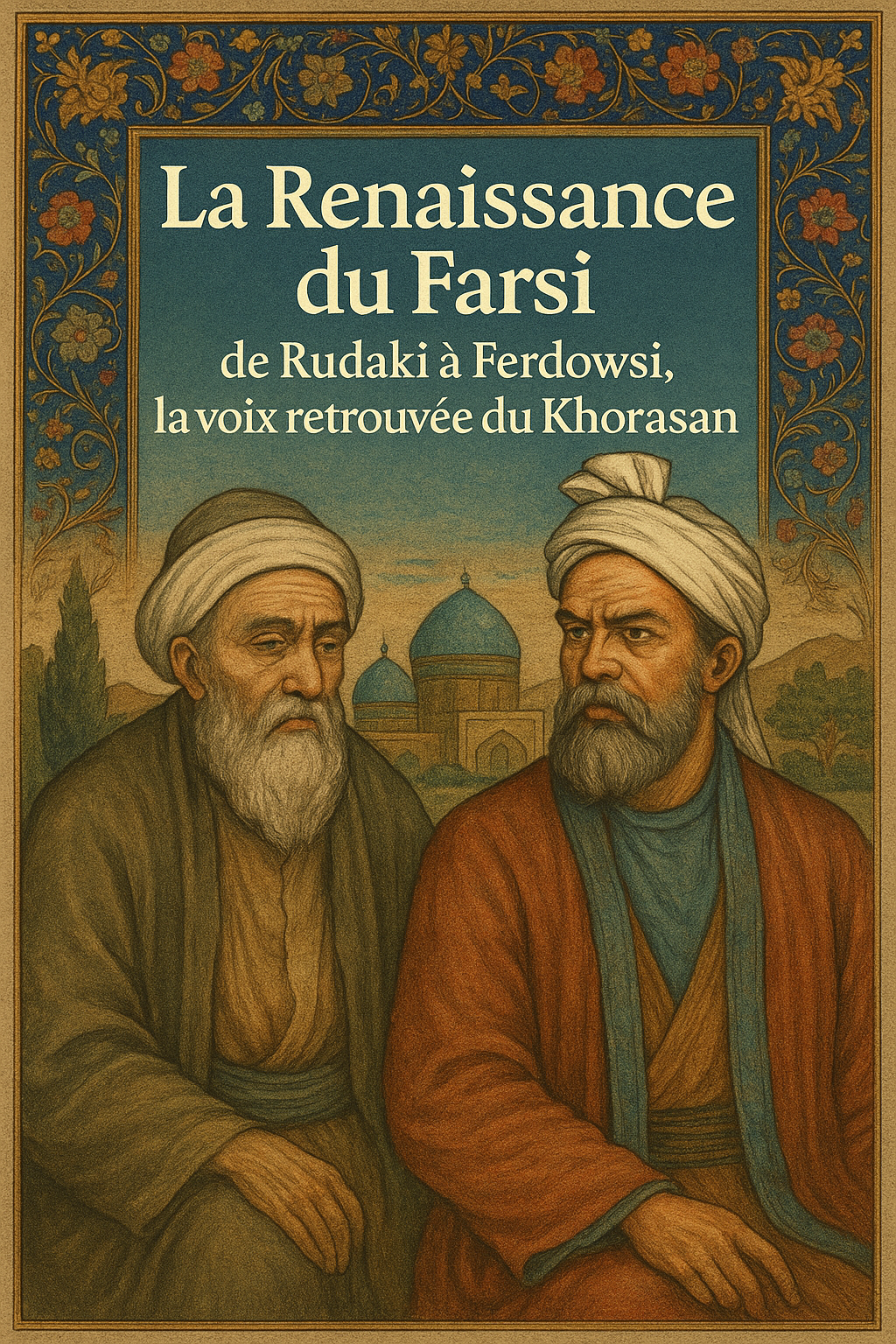
Rudaki, le musicien de la renaissance
Né vers 859 dans un village proche de Samarkand, Rudaki grandit aveugle, mais habité d’une mémoire prodigieuse et d’une sensibilité poétique rare. Toutefois, une légende raconte que cette cécité n’était pas d’origine : selon certaines sources anciennes, Rudaki aurait été rendu aveugle à la fin de sa vie, après avoir été frappé à la tête avec un recueil de ses propres écrits — une punition cruelle, infligée pour des raisons politiques ou symboliques, marquant la fin tragique d’un génie de la parole.
Protégé par la cour samanide de Boukhara, il fut le premier à composer de la poésie en persan (farsi) dans un cadre officiel. À cette époque, l’arabe dominait encore la science et la littérature. Rudaki fut l’un des premiers à restaurer la langue du peuple dans les cercles du pouvoir, prouvant qu’elle pouvait porter l’élégance, la philosophie, l’amour et la musique.
Grâce à lui, le farsi retrouva sa place dans les arts, la culture et l’imaginaire collectif d’un monde post-sassanide, entre l’Asie centrale, le Grand Khorasan et l’actuel Afghanistan.
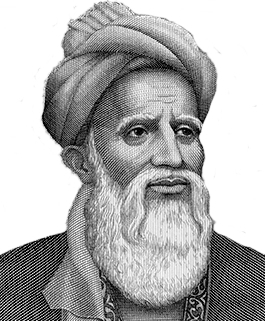
D’où vient le mot “Dari” ?
Le terme “farsi dari” (ou simplement dari) désigne la forme orientale du persan, encore parlée aujourd’hui en Afghanistan. Ce mot vient du “darbar”, qui signifie la cour royale ou le palais du souverain. Le dari était ainsi la langue parlée à la cour des rois et des élites, en particulier sous les empires sassanide et samanide.
Langue de l’administration, de la poésie et de la haute société, le dari symbolisait le raffinement, la diplomatie et l’autorité. Ce n’est pas une simple variante régionale : c’est la continuité d’une tradition de culture de haut rang, ancrée dans les terres de Balkh, Hérat, Boukhara ou Nishapur.
Ferdowsi, le gardien de l’identité
Un siècle après Rudaki, un autre géant se lève : Ferdowsi (v. 940–1020), originaire de Tūs, au cœur du Khorasan. Son œuvre, le Shāhnāmeh (le Livre des Rois), est un monument littéraire et politique. En plus de raconter l’histoire mythologique et héroïque da région, il a sauvé la langue persane de l’oubli.
En refusant d’utiliser l’arabe dans son œuvre, Ferdowsi a prouvé que le persan seul pouvait porter toute la grandeur d’un peuple. Son combat n’était pas seulement linguistique, mais civilisationnel. Il affirmait que connaître sa langue, c’est défendre son histoire, son âme, sa mémoire.

Une langue, une mémoire, un héritage
Aujourd’hui, parler le dari, c’est hériter d’une longue tradition de poésie, de philosophie, de résistance culturelle. C’est s’inscrire dans la continuité de Rudaki, de Ferdowsi, de Jami, de Khayyam, de Rumi, et tant d’autres. C’est aussi, pour la jeunesse afghane et khorasanie, un acte de conscience et de fierté.
Au-delà des frontières modernes, la langue farsi dari est une terre intérieure, un lien invisible mais puissant entre ceux qui partagent une culture raffinée, millénaire et résiliente.
Laisser un commentaire